
L’importance historique de la science indienne est comparable à celle de la science grecque. La première a été adoptée au Tibet, en Asie centrale, en Indochine et en Indonésie, dans certains milieux chinois et japonais ; la seconde a servi de modèle dans la Chrétienté et dans l’Islam. A l’exception du domaine chinois, étendu mais limité et souvent entamé par l’Inde, elles se sont donc partagées le monde jusqu’à l’essor scientifique moderne que l’on peut considérer comme un affranchissement de la tradition scientifique grecque*.

De nombreux problèmes de chronologie se sont posés et certains auteurs ont cru pouvoir discerner l’influence d’une science sur l’autre. En fait, il semble possible d’admettre un développement parallèle des deux traditions médicales, indiennes et grecques. Ainsi que l’a écrit M. Jean Filliozat, si « les traités spéciaux de science indienne qui nous sont parvenus sont des œuvres didactiques relativement tardives, ce ne sont pas, la plupart du temps, des compositions originales d’initiateurs, ce sont les manuels d’écoles qu’à un certain moment le succès a rendu traditionnels et qui, à cause de cela, nous ont été conservés de préférence à ceux plus anciens qu’ils reproduisaient plus ou moins.

Leur date de rédaction n’a donc qu’une importance secondaire ; elle n’est pas valable pour marquer l’époque de la création des doctrines qu’ils contiennent. »
Les plus anciens traités de médecine classique indienne sont les Samhitâ ou Corpus dits de Bhela, Caraka et Suçruta, tous trois transmettant une même tradition, celle de l’Ayurvéda, « science de la longévité ». On sait que selon Ctésias (IVe siècle avant J.-C.), l’un des premiers médecins grecs ayant parlé de l’Inde, les Indiens étaient sujets à peu de maladies et pouvaient vivre deux cents ans.
A l’origine, aux Indes comme en Égypte ou en Chine, la magie joua un grand rôle en thérapeutique et l’on connait de nombreuses incantations aux démons pour guérir ou provoquer la maladie, mais lorsque se forma la tradition de l’Ayurvéda, le médecin n’était déjà plus un sorcier, c’était un praticien et un savant. Il prenait en compte des données de l’expérience et les organisait d’après une théorie générale de l’homme.

« Le médecin, le patient, le remède et l’infirmier sont les quatre piliers de la médecine sur lesquels repose la guérison, lit-on dans le traité attribué à Suçruta. Quand trois de ces piliers sont ce qu’ils doivent être, alors, avec l’aide de premier, qui est médecin, la guérison sera complète, et c’est en très peu de temps que le médecin pourra guérir une grave maladie. »
Un peu plus loin, le même texte donne cette définition : « Pour qu’un remède soit considéré comme un vrai pilier de la médecine, il doit être composé de plantes poussées dans un sol excellent, cueillies dans un jour favorable et il faut l’administrer en dose et en temps convenables. »

La légendaire histoire du médecin Jivaka montre jusqu’où pouvait être poussée la phytothérapie indienne. Jivaka appris son art auprès du médecin Pingala. Après sept années, l’élève demanda au maître si son instruction était complète. Pingala ne répondit pas mais, à son tour, posa une question. Il demanda à Jivaka d’énumérer toutes les plantes inutiles au point de vue médical poussant dans une région donnée. Jivaka se trouva dans l’impossibilité de désigner une seule plante dépourvue de toute vertu curative. « Va, lui dit son maître, tu possèdes, désormais, toute la science médicale ! J’ai été jusqu’ici le premier et le seul à la posséder dans tout Jambuddipa, après ma mort, c’est toi qui me succéderas. »
Jivaka guérissait tous les malades. « Parfois avec une seule plante, il traitait toutes les maladies, et parfois, pour une seule maladie, il employait toutes les plantes. Parmi toutes les herbes de l’univers entier, il n’en était pas une seule dont il ne pût faire usage ; parmi toutes les maladies de l’univers, il n’en n’est pas une seule qu’il ne guérit. »

Parmi les plantes médicinales les plus usitées, il est possible de citer l’ail, les myrobolans, le poivre, le gingembre, l’azore, le béla (antidysenterique), le ricin (purgatif et désinfectant cutané dans la lèpre), le lycium (sorte de caoutchouc encore utilisé aujourd’hui aux Indes dans le traitement des affections oculaires), le tamarin (laxatif), le chanvre, le cardamone, l’écorce de mudar (tonique), l’aconit, etc. Les Indiens usaient également de produits animaux comme le bézoard, la vipère, l’urine de vache, et de produits minéraux tels que le sulfate de fer, le borax et l’alun. M. Bouvet a trouvé dans le texte attribué à Suçruta la preuve que dans la thérapeutique indienne antique on pratiquait l’infusion, la macération, la décoction, et qu’on savait préparer des poudres, des pilules, des onguents et des préparations liquides, employées comme collyres, lavements ou liniments.

La thérapeutique suivie par l’auteur du texte attribué à Suçruta, par exemple dans les cas de phtisie pulmonaire, peut être comparée à celle des phtisiologues d’il y a cinquante ans et cette comparaison permet de se faire une idée assez nette du niveau expérimental auquel étaient parvenus les médecins indiens d’il y a plus de deux mille ans. Suçruta ordonnait les bains, les aspersions, les frictions, une diététique progressivement ascendante ;, le lait et les raisins, le beurre et les aliments cuits à l’aide de ce corps gras, les plantes apéritives, digestives et laxatives, les substances fébrifuges, un régime carné très varié, le vin de vigne et son alcool, le séjour dans les étables et l’habitation dans des régions très élevées.

Le plus souvent les plantes médicamenteuses se trouvaient mélangées aux aliments. De nombreuses plantes étaient administrées au même moment. Ainsi, pour un phtisique dont la maladie commençait seulement, les frictions étaient conseillées, puis un mélange de beurre de chèvre et des plantes suivantes : Hedysarum gangeticum, Convolvulus paniculatus, Dandotpala, Hedysarum lapodioides, Flacourtia cataphracta, Hemionites cordifolia, Asparagus racemosus, Eschites frutescens, Dalbergia sisu, Bryonia grandis, Rishab’haka, Whrigtea antidysenterica, Phasoleus trilobus, Solanum melongena, Ricinus communis recens, Clitoria ternata, Tragia involucrata, Carpopogon pruriens.
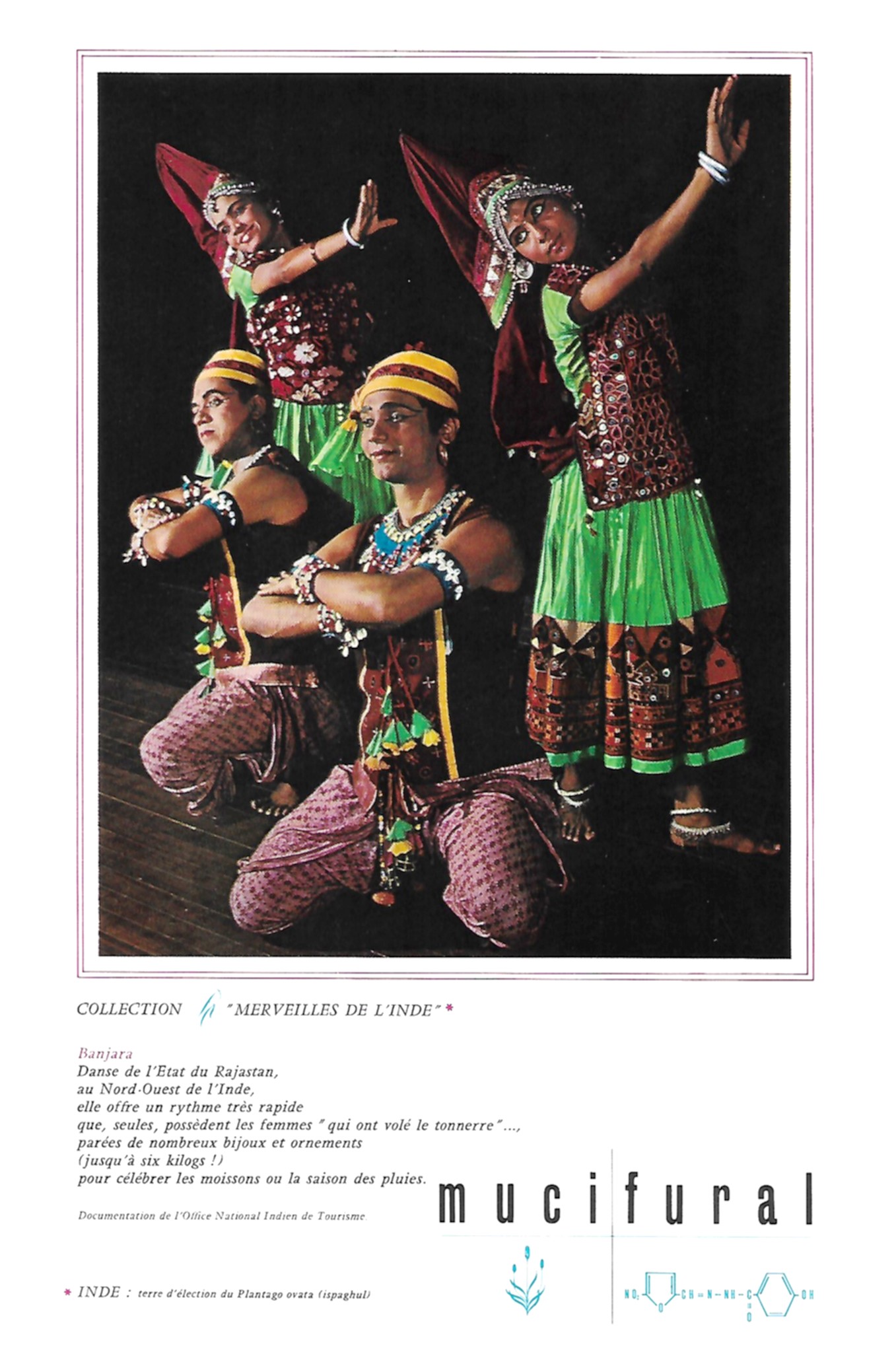
Selon Suçrata, « les fruits de Hedysarum logopodioides sont froids, réfrigérants, suaves, purgatifs, âpres, doux, d’une saveur astringente, ils combattent les vices de l’air et du phlegme ». « La racine ou bulbe de Convolvulus paniculatus a une saveur prononcée ; elle est froide, douce, lourde, contraire aux hémorragies bilieuses, stimulante, nutritive ; elle produit le lait, la force, l’accroissement et la santé ; elle est très diurétique, elle guérit les trois humeurs : c’est un élixir de vie. » « Asparagus racemosus est froid, agréable, purgatif, stimulant ; il procure l’intelligence, une bonne digestion, il augmente les forces, il guérit les vices des humeurs ; c’est un élixir de vie ; sa racine supprime les hémorragies bilieuses, elle est froide, douce, lourde, elle produit le lait, la force et l’accroissement. » « Solanum melongena est agréable et très léger ; il a une saveur prononcée ; il guérit la fièvre, la dyspnée, le catarrhe, l’inappétence et les vices des humeurs ; quand il est ancien, il passe pour réchauffer, pour être alcalin et bilieux ; c’est le plus renommé de tous les légumes amères », etc.
Ainsi, Suçruta a chanté l’asperge (Asparagus racemosus) et l’aubergine (Solunum melongena) comme plus tard le feront certains moines poètes, médecins et phytothérapeutes. Cela n’aide-t-il pas à faire pardonner les plaies traitées par le crottin de cheval, les brûlures soignées à la graisse de singe et l’urine de vache si chère à la thérapeutique populaire indienne ?? Et puis, est-ce seulement aux Indes que de tels remèdes ont été employés ?

*D’après un texte de P. Boussel paru dans le Moniteur des Pharmacies en 1962 (N°549)
